| |
Stratégie
québécoise sur la biodiversité I Législation et incitatifs
I Administration et gestion
Chronologie
de la conservation de la biodiversité au Québec
En 1992, le gouvernement
du Québec a officiellement ratifié la Convention sur la diversité biologique
(CDB) issue du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. En même temps,
le Québec s'est lancé dans l'élaboration d'une stratégie provinciale
pour mettre en oeuvre les objectifs de la CDB.
En 1996, le Québec est devenu
la première province à se doter d'une stratégie sur la biodiversité.
Le plan d'action québécois pour la mise en oeuvre de la stratégie sur
la convention sur la diversité biologique illustre les mesures que devra
prendre le gouvernement au cours des quatre années suivantes pour atteindre
les objectifs de la stratégie québécoise sur la biodiversité (SQB).
(QBS)
Aperçu
de la stratégie québécoise sur la biodiversité
L'idée maîtresse de la
stratégie québécoise sur la biodiversité est la conservation des espèces
vivantes et de leurs habitats au Québec et également l'utilisation
durable de toutes les ressources vivantes. La SQB se compose en fait
de deux documents, la Stratégie de mise en oeuvre et le Plan
d'action.
La Stratégie de mise
en oeuvre met en contexte la SQB : elle donne un court aperçu
de la biodiversité du Québec, explique sa valeur pour les citoyens
du Québec et l'état actuel de la conservation et de l'utilisation
des ressources vivantes du Québec. La Stratégie de mise en oeuvre
présente ensuite les objectifs, les buts et les mesures que le gouvernement
estime nécessaires à la protection de la diversité biologique du Québec.
Le
Plan d'action fournit des précisions sur la façon dont le Québec
entend atteindre ses buts au cours des quatre prochaines années. Il
décrit plus de 400 actions qui seront engagées par le gouvernement
provincial pour que se concrétisent les mesures décrites dans la Stratégie
de mise en oeuvre.
(Stratégie
québécoise de mise en oeuvre 1996, Plan
d'action québécois sur la biodiversité 1996)
Toute la stratégie québécoise
sur la biodiversité est accessible en ligne sur ce
site.
Comment est organisée
cette stratégie?
La stratégie est subdivisée
en 12 catégories ou secteurs énumérés ci-après. À propos de chaque
secteur, il faut prendre un certain nombre de mesures. Pour prendre
ces mesures, il faut engager des actions qui sont décrites après.
Les actions portent sur différents types d'efforts qui vont d'une
multiplication des recherches à l'amélioration des procédés industriels
en passant par la diffusion d'informations auprès du public et l'intégration
des connaissances ancestrales des peuples autochtones dans la prise
de décisions de conservation.
Quelles sont les
12 catégories visées par la stratégie québécoise sur la biodiversité?
- Démarche de mise en
oeuvre (générale)
- Ressources naturelles
conservées
- Ressources fauniques
- Ressources forestières
- Ressources agricoles
- Biotechnologie
- Milieu
urbanisé
- Ressources minières
- Ressources énergétiques
- Milieu nordique
- Urgences environnementales
- Éducation
(Site
Web de la stratégie québécoise sur la biodiversité)
Pour mieux comprendre l'organisation
de la stratégie, prenons un exemple tiré du secteur des ressources
forestières de la SQB...
Exemple du rapport entre
les buts, les mesures et les actions dans la SQB.
|
Objectif
|
Mesures
|
Actions
|
| 1.
Accroître les connaissances sur les écosystèmes et les espèces. |
1.1
Favoriser les activités de recherche sur les écosystèmes dans les
aires protégées. |
- 98. Déterminer la possibilité d'utiliser les forêts actuellement
protégées comme unités de contrôle dans les recherches forestières.
- 99. Préciser les priorités de recherche pour les parcs en
en faisant des critères de comparaison.
- 100. Préciser les mesures susceptibles d'avoir une incidence
sur les écosystèmes.
|
| |
1.2
Évaluer le réseau existant d'aires protégées du Québec sous l'angle
de la diversité des écosystèmes forestiers. |
- 101. Établir un cadre d'analyse et préciser les informations
manquantes.
- 102. Analyser la diversité des écosystèmes forestiers à l'intérieur
comme à l'extérieur des zones protégées.
- 103. Élaborer une méthodologie en vertu de laquelle les parcs
serviront d'unités de comparaison pour mesurer les variations
dans les processus écologiques naturels.
|
| |
1.3 Préciser et accroître nos connaissances sur les forêts exceptionnelles. |
- 104. Créer un groupe de travail pour qu'il entreprenne des
travaux dans ce secteur.
- 105. Préciser les écosystèmes rares ou fragiles dans les parcs
ou les réserves écologiques et leur accorder une protection
supplémentaire.
- 107. Définir et déterminer les critères d'identification,
analyser les moyens de préserver et de concevoir une technique
visant à cartographier les écosystèmes forestiers exceptionnels.
|
La plupart des éléments
de l'activité humaine, notamment les activités économiques et récréatives,
ont une incidence directe ou indirecte sur la diversité biologique.
C'est pourquoi la SQB dépend du soutien de nombreux ministères pour
vraiment porter fruit. Mentionnons entre autres :
- Ministère des Affaires municipales
- Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation
- Ministère de l'Education
- Ministère de l'Environnement
et de la Faune
- Ministère de l'Industrie,
du Commerce, de la Science et de la Technologie
- Ministère
des Relations internationales
- Ministère des
Ressources Naturelles
- Ministère de
la Santé et des Services sociaux
- Ministère des
Transports
- Comité interministeriel
sur l'éducation relative à l'Environnement
- Hydro-Quebec et
la fondation de la faune du Quebec s'y sont joints également.
|
(SQB)
Intégration
avec les efforts fédéraux en matière de conservation
Les efforts déployés par
le Québec dans le domaine de la conservation complètent sous bien
des rapports ceux du Canada. Par exemple, le Plan d'action interministériel
pour favoriser la survie du béluga du Saint-Laurent est un projet
qui fait appel à la participation conjointe d'Environnement Canada
et du ministère québécois de l'Environnement et de la Faune. Le Plan
d'action Saint-Laurent est un effort important visant à protéger et
à conserver le Saint-Laurent et son bassin hydrographique. Au nombre
des objectifs de ce plan, mentionnons la réduction des contaminants
qui s'infiltrent dans le fleuve, la protection de la biodiversité
du fleuve et de son bassin hydrographique et la participation des
communautés riveraines à ces efforts.
Le maintien de la biodiversité
a toujours été un élément important du plan et passe par la protection
et le rétablissement des habitats fauniques et l'élaboration de plans
de rétablissement des espèces menacées, comme le béluga.
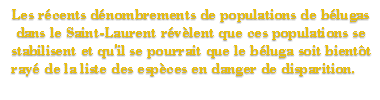
(Site
Web du Plan d'action Saint-Laurent)
Collaboration
avec les ONG
Le Québec  collabore
également avec des organisations non gouvernementales (ONG) à l'échelle
locale, nationale et internationale. Parmi les projets entrepris avec
des ONG, il y a des projets d'éducation et d'information. Par exemple,
l'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), avec
le concours de nombreuses organisations, dont le gouvernement du Québec,
a créé le site Web sur l'Écoroute conçu comme
source d'information sur l'environnement québécois et le développement
durable. collabore
également avec des organisations non gouvernementales (ONG) à l'échelle
locale, nationale et internationale. Parmi les projets entrepris avec
des ONG, il y a des projets d'éducation et d'information. Par exemple,
l'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), avec
le concours de nombreuses organisations, dont le gouvernement du Québec,
a créé le site Web sur l'Écoroute conçu comme
source d'information sur l'environnement québécois et le développement
durable.
Par ailleurs, le gouvernement
 du
Québec a financé les initiatives prises par plusieurs ONG en vue de
concevoir et de mettre en oeuvre des programmes de conservation. Deux
exemples notables sont la Campagne sur les
espaces en danger et le Centre de données sur le patrimoine naturel.
La Campagne sur les espaces en danger, analysée plus à fond à la section
3.1 du chapitre sur la diversité des espèces par rapport à la diversité
des paysages, a été lancée par le WWF Canada en vue de conserver la
diversité biologique en protégeant un réseau de zones naturelles représentatives
du Canada. La campagne a reçu l'aval officiel de toutes les provinces
et des territoires du Canada en 1992. Le Centre de données sur le
patrimoine naturel a été créé par le ministère québécois de du
Québec a financé les initiatives prises par plusieurs ONG en vue de
concevoir et de mettre en oeuvre des programmes de conservation. Deux
exemples notables sont la Campagne sur les
espaces en danger et le Centre de données sur le patrimoine naturel.
La Campagne sur les espaces en danger, analysée plus à fond à la section
3.1 du chapitre sur la diversité des espèces par rapport à la diversité
des paysages, a été lancée par le WWF Canada en vue de conserver la
diversité biologique en protégeant un réseau de zones naturelles représentatives
du Canada. La campagne a reçu l'aval officiel de toutes les provinces
et des territoires du Canada en 1992. Le Centre de données sur le
patrimoine naturel a été créé par le ministère québécois de l'Environnement et de la Faune en 1988, et il représente la contribution
du Québec au réseau du Centre de données sur le patrimoine naturel
et la conservation établi par l'organisme de conservation international,
la Société pour la conservation de la nature. L'objectif de ces centres
de données est de recueillir et de diffuser des renseignements sur
les espèces en péril dans une province ou un État.
l'Environnement et de la Faune en 1988, et il représente la contribution
du Québec au réseau du Centre de données sur le patrimoine naturel
et la conservation établi par l'organisme de conservation international,
la Société pour la conservation de la nature. L'objectif de ces centres
de données est de recueillir et de diffuser des renseignements sur
les espèces en péril dans une province ou un État.
Législation
et incitatifs qui visent à protéger la biodiversité
Le gouvernement peut veiller
à la protection de la biodiversité en adoptant des lois et des règlements.
Il y a quatre grandes lois qui favorisent la conservation des espèces
alors que d'autres visent plutôt la protection générale de l'environnement.
On trouvera le texte exact des lois et règlements sur le
site Web des Publications du Québec.
Législation
sur la conservation
Loi sur les
parcs
La Loi sur les parcs, adoptée
en 1978, sert de cadre législatif à la création (et à l'abolition)
de parcs (de conservation ou de loisirs) au Québec. Cette loi interdit
la chasse et l'extraction des ressources dans les parcs provinciaux,
réglemente la vente ou l'échange d'un parc et confère au gouvernement
du Québec le pouvoir d'établir des règlements sur l'utilisation de
chaque parc.
Loi sur les
réserves écologiques
La Loi sur les réserves
écologiques, adoptée en 1974, traite de l'établissement de réserves
écologiques. Les réserves sont établies pour : maintenir les habitats
dans leur état naturel - conserver certains secteurs pour la recherche
scientifique et l'éducation - protéger les espèces vulnérables ou
en danger de disparition. La Loi comporte des précisions sur l'établissement
d'une réserve, son acquisition, les activités réglementées dans la
réserve, les droits d'accès, les inspections.
Loi sur les
espèces menacées et vulnérables
La Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables a été adoptée en 1989 et c'est la loi provinciale
qui assure la protection juridique des espèces menacées ou en danger.
Entre autres choses, cette loi établit :
- La procédure à suivre
pour désigner une espèce en péril.
- Les droits et responsabilités
du gouvernement à l'égard de la protection des espèces et de la
protection de leurs habitats.
Avec force détail, cette
Loi stipule les procédures à suivre pour désigner une espèce en péril
et pour protéger juridiquement les espèces en danger de disparition.
Il s'agit là de deux procédures éminemment différentes.
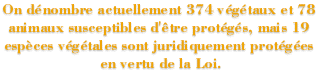
Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune
La Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (adoptée en 1983) établit :
- Les responsabilités
du gouvernement en ce qui concerne la protection des populations
fauniques. Une application importante concerne la réglementation
de la pêche et de la chasse au Québec.
- Les responsabilités
des agents de conservation chargés de faire appliquer les lois qui
ont un rapport avec la conservation (comme les 3 lois mentionnées
plus haut).
- Les responsabilités
relatives à l'éducation du public sur ces lois et règlements.
Lois
sur la protection de l'environnement
Environmental
Protection act
Depuis 1972, La Loi sur
la protection de l'environnement vise l'établissement de programmes
de conservation, souligne les plans qu'il faut adopter pour protéger
et gérer l'environnement et établit des plans d'intervention d'urgence
qui aident à prévenir toute forme de contamination ou de destruction
de l'environnement.
(Site
Web des Publications du Québec)
Autres
lois favorisant la protection de l'environnement
Plusieurs autres lois qui
visent à réglementer diverses activités industrielles (foresterie,
exploitation minière, industrie des pâtes et papiers) ou des éléments
de l'environnement (air, eau, sol) contiennent des dispositions visant
la protection et la remise en état de l'environnement et par voie
de conséquence, la protection des habitats et des écosystèmes qui
préservent la biodiversité des espèces.
Instruments
de planification
Plan d'utilisation
des terres publiques
92 % du
territoire québécois relève du domaine public. Le principal instrument
d'aménagement de cette assise territoriale est le plan d'utilisation
des terres publiques désigné dans la Loi sur l'affectation des terres
du domaine public. Selon cette loi, les terres publiques sont classées
dans trois catégories :
- Les terres où l'extraction
des ressources est interdite.
- Les terres où l'extraction
des ressources est autorisée.
- Les terres où l'extraction
des ressources est une priorité.
Le plan d'utilisation des
terres publiques peut ainsi protéger certaines terres publiques contre
l'exploitation des ressources, ce qui englobe des activités comme
l'exploitation forestière, l'exploitation de ressources énergétiques
et l'exploitation minière. (Zinger,
1998, comma. pers.)
MRC
Le Québec est subdivisé
en 96 municipalités régionales de comté (MRC) et en 3 communautés
urbaines. En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chaque
municipalité est tenue d'avoir son propre plan de développement. Ces
plans prévoient la protection des espaces naturels comme les milieux
humides. En d'autres termes, même au niveau des MRC, des terres peuvent
encore être zonées comme aires de conservation, si elles n'ont pas
été désignées comme parcs, comme réserves ou comme secteurs où l'extraction
des ressources est interdite. (Zinger,
1998, comma.pers.)
Administration
et gestion
Le gouvernement du Québec
utilise deux méthodes pour protéger la biodiversité indigène : la protection
des habitats et la protection des différentes espèces.
Habitats
protégés
Qu'est-ce
qu'une aire protégée?
L'Union mondiale
pour la nature (UICN) définit en ces termes une aire protégée
:
Espace terrestre et(ou)
marin voué expressément à la protection et au maintien de la diversité
biologique et des ressources naturelles et culturelles connexes
et aménagé par des moyens juridiques ou d'autres moyens efficaces.
Cette définition englobe
quantité d'objectifs différents pour lesquels une aire peut être protégée,
depuis la protection d'un milieu sauvage jusqu'à l'aménagement des
ressources en passant par les loisirs. C'est pourquoi en 1994, l'UICN
a élaboré un système international de classification des aires protégées
dans le monde entier qui comporte six catégories distinctes :
Cat. I: Réserve
naturelle intégrale : aire protégée gérée principalement à des fins
scientifiques.
Cat. II: Parc
national : aire protégée gérée principalement dans le but de protéger
les écosystèmes à des fins récréatives.
Cat. III: Monument
naturel : aire protégée gérée principalement dans le but de préserver
des éléments naturels spécifiques.
Cat. IV: Aire
de gestion des habitats ou des espèces : aire protégée gérée principalement
à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion.
Cat.
V: Paysage terrestre ou marin protégé : aire protégée gérée
principalement dans le but d'assurer la conservation de paysages
terrestres ou marins à des fins récréatives.
Cat. VI: Aire
protégée de ressources naturelles gérées : aire protégée gérée principalement
à des fins d'utilisation durable des écosystèmes naturels.
Ces catégories présupposent
un gradient d'intervention humaine. Même s'il reste peu d'endroits
au monde que l'on peut encore décrire comme vierges et à caractère
vraiment naturel, on peut considérer qu'un système naturel est un
système où l'impact de l'être humain n'a pas dépassé celui d'autres
espèces indigènes et n'a pas perturbé la structure de l'écosystème.
C'est ainsi que les catégories I à III visent
la protection des espaces naturels, tandis que les catégories IV à
VI visent les aires protégées assujetties à une modification et à
une intervention humaine. (UICN,
1994)
À ce jour, un infime
pourcentage du territoire québécois est protégé.
Les aires protégées du Québec doivent avoir comme objectif primordial
la protection et le maintien de la biodiversité. Cela veut dire que
toute activité menée dans les aires protégées ne doit pas altérer
leur structure écologique. Parmi les activités incompatibles, mentionnons
les coupes rases, les plantations forestières monospécifiques, l'exploitation
minière, l'exploitation des ressources énergétiques et la récolte
non durable. (MEF,
1998)
Le
Fonds mondial pour la nature estime qu'en 1998, 4,2 % du territoire
québécois est désigné pour être protégé, mais qu'à peine 0,5 % est
en fait juridiquement protégé comme aires naturelles (catégories I
à III de l'UICN), ce qui représente environ 6,5 millions d'hectares.
2,2 % du territoire québécois est classé comme aires protégées moyennant
l'intervention de l'être humain (catégories IV à VI de l'UICN).
Il est intéressant également
de noter que 75 % de toutes les terres protégées du Québec se trouvent
dans les biomes de la forêt nordique, les 25 % restant étant divisés
entre les biomes de la toundra, de la taïga et de la forêt décidue.
(Rapport
d'étape sur le Québec 1997-1998, WWF, 1998; Zinger,
1998, comma. pers., MEF
1998)
La ventilation
du territoire protégé en 1990 entre les cinq types de biomes était
:

(SQB)
Quelles
sont les catégories de terres protégées au Québec?
La province de Québec a
son propre système de classification des aires protégées. L'achat
ou l'aménagement d'aires protégés peut tomber entre les mains du gouvernement
fédéral ou provincial, des municipalités, des organisations non gouvernementales,
du secteur privé ou des collectivités locales, sous réserve que les
objectifs des aires protégées soient respectés.
Les aires protégées naturelles
du Québec appartiennent à 18 catégories. Les catégories qui englobent
les aires protégées les plus nombreuses sont :
- habitats fauniques (36
000 km2)
- parcs provinciaux (5
500 km2)
- parcs
nationaux (886 km2)
- réserves écologiques
(702 km2)
- rivières à saumons (les
rivages) (744 km2)
Le rapport annuel 1997-1998
du gouvernement provincial sur les aires protégées se trouve sur le
site Web du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
Par ailleurs, on peut consulter
la section sur la Campagne pour les espaces en danger conçue par le
WWF à la section 3.1 du chapitre de la diversité des espèces vs diversité
des paysages.
Habitats fauniques
Les habitats fauniques
servent à protéger l'habitat d'une espèce ou d'un groupe d'espèces
cibles. L'intervention humaine et l'exploitation des ressources
sont autorisées dans ces secteurs pour autant qu'elles n'aient pas
d'effets préjudiciables sur l'habitat de l'espèce ciblée et que
les activités n'enfreignent pas les objectifs primordiaux des aires
protégées. Étant donné que l'exploitation contrôlée est autorisée
dans ces aires protégées, la plupart appartiendraient à la catégorie
IV selon le système de classification de l'UICN.
Les habitats fauniques
relèvent du Règlement sur les habitats fauniques de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, ch. C-61.1).
(MEF,
1998)
Parcs provinciaux
Il y a deux grandes catégories
de parcs provinciaux : les parcs gérés principalement à des fins
de conservation et les parcs gérés à des fins de loisirs. Les parcs
établis à des fins de conservation tiennent lieu de protection permanente
aux aires naturelles exceptionnelles (Miguasha, île Bonaventure
et rocher de Percé). Les parcs récréatifs servent eux aussi à protéger
des aires représentatives du patrimoine naturel du Québec, mais
également à faciliter les activités récréatives et non destructrices
comme la randonnée et le ski.
Les parcs provinciaux
sont régis par la Loi sur les parcs (LRQ, ch. P-9) et toute forme
d'exploitation, d'utilisation et de perturbation de ce type d'aire
protégée est interdite, sauf en ce qui concerne la pêche sportive
dans certains secteurs. Ces aires sont des aires de catégorie II
selon l'UICN.
Dix-neuf parcs provinciaux
ont été désignés au Québec à des fins de conservation et de loisirs.
Clicker
ici pour une liste et une carte des parcs provinciaux.
(MEF,
1998)
Parcs nationaux
Les parcs
nationaux servent à protéger les aires représentatives des régions
à grande échelle du Canada afin d'inciter la connaissance, l'éducation
et l'interprétation de la nature et pour le plaisir des générations
futures.
Les parcs nationaux sont
de compétence fédérale et sont régis par la Loi sur les parcs nationaux
(LRC, ch. N-13). À l'instar des parcs provinciaux, il est interdit
d'utiliser ou d'extraire les ressources dans les parcs nationaux,
ce qui fait qu'ils appartiennent à la catégorie II de l'UICN.
Pour une liste des parcs
nationaux du Québec, visiter le
site Web de Parcs Canada.
(MEF,
1998)
Réserves
écologiques
Les réserves écologiques
diffèrent des parcs provinciaux en ce sens que leur objectif primordial
est de protéger les écosystèmes vierges ou les aires qui revêtent
une grande importance écologique.
Une aire peut être désignée
réserve écologique pour quantité de raisons : parce qu'il s'agit
d'un paysage fragile, rare ou vierge ou pour protéger un ensemble
d'espèces représentatives d'un écosystème ou d'espèces rares ou
en danger de disparition.
Quelle que soit la raison
pour laquelle une aire est désignée comme réserve écologique, toutes
les réserves représentent des aires relativement peu touchées par
l'être humain. À ce titre, les activités dans les réserves sont
limitées aux recherches scientifiques et à certaines activités pédagogiques.
Contrairement à d'autres aires à statut particulier
du Québec, les activités récréatives et l'extraction des ressources
y sont rigoureusement interdites. De ce fait, ces aires appartiennent
à la catégorie Ia de l'UICN.
Les réserves écologiques
tombent sous le coup de la Loi sur les réserves écologiques (LRQ,
ch. R-26.1). On recense actuellement 57 réserves écologiques au
Québec qui recouvrent plus de 70 000 hectares (700 km2).
Vous trouverez une description
plus détaillée des réserves écologiques ainsi qu'une liste des réserves
du Québec sur le site Web du MEF du Québec, ici.
Une
carte des réserves est également disponible sur le site Web du MEF
du Québec, ici.
(MEF,
1998)
Rivières
à saumons
Si les rivières proprement
dites ne sont pas réglementées, leurs rives sont considérées comme
des aires protégées. En vertu de la Loi sur les forêts (LRQ, ch.
F-4.1, art. 28.2), une bande de 60 mètres de large de part et d'autre
de la rivière est protégée contre toute exploitation forestière
afin de protéger les frayères à saumons (reproduction) qui doivent
rester froides et exemptes de sédiments.
Étant donné que l'exploitation
d'autres ressources est autorisée dans cette catégorie d'aire protégée
(comme la chasse), elle est classée comme aire de catégorie VI selon
l'UICN.
(MEF,
1998)
Le Québec possède également
d'autres aires de conservation qui ne sont pas classées comme aires
protégées vu que leur objectif primordial n'est pas la protection
de la biodiversité ou de la faune. Il peut s'agir d'aires in situ
comme les camps de chasse et les zones d'exploitation contrôlée (ZEC),
ou d'établissements in situ comme les zoos et les jardins botaniques.
Nous avons néanmoins axé cette partie du texte essentiellement sur
les aires naturelles.
Espèces
protégées
Une proportion importante
d'espèces de plantes vasculaires et de vertébrés sont en péril.
Les 374 espèces végétales
susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables concentrent
près de 20 % de toutes les espèces de plantes vasculaires du Québec.
11 % (77 espèces) de tous les vertébrés sont également considérés
en péril. Beaucoup de ces espèces vivent dans des habitats aquatiques
ou sont originaires du bassin hydrographique
du Saint-Laurent.
On trouvera d'autres précisions
sur la distribution des espèces en péril dans la section du site Web
réservée aux espèces
en péril.
Nombre
d'espèces par biome au Québec (adapté de la stratégie québécoise de
mise en oeuvre, tableau 1).
| Biome |
Description |
Plantes vasculaires et non vasculaires |
Vertébrés |
| Toundra |
Arctique et alpine |
892
38*
|
160
9
|
| Taïga |
Plateaux rocailleux déformés avec une forêt d'épinettes noires/lichens
ouverte |
781
1
|
221
13
|
| Ceinture d'épinettes |
Épinettes noires sur un lit de mousse |
1144
26
|
281
17
|
| Ceinture de sapins baumiers |
Association de résineux (sapins baumiers et pins) et de feuillus
(bouleaux, trembles) |
1568
99
|
371
30
|
| Forêt décidue |
Les bouleaux, les érables et les hêtres y sont courants |
2150
244
|
442
50
|
| Total |
|
9044**
374
|
653
72
|
* Le nombre d'espèces menacées ou vulnérables est indiqué en italiques.
** On ajoute aux totaux les espèces de champignons et d'algues. Certaines
espèces se retrouvent dans plusieurs biomes.
|

